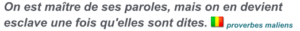Itinéraire de l’opposant politique
J’ai eu mon BEPC en juin 1962, et j’ai quitté le séminaire comme je suis entré. C’est-à-dire sans trop savoir pourquoi mon père m’y avait conduit. Un jour, alors que je venais de donner un cours de musique à des jeunes gens, mes amis Boniface Dagri, Koudougnon Ballet, Lavry Bernardin me retrouvent chez moi et me disent :
– “On quitte le séminaire. Nous allons à Abidjan pour rentrer au Lycée Classique.
– Je viens avec vous, leur ai-je répondu.”
C’est ainsi que je suis allé prendre mes dossiers et que je me suis rendu à Abidjan. C’était en 1962 : une grande aventure. Et quelle aventure !
Au Lycée Classique, venant d’un établissement privé, j’ai passé la première année à l’externat. Il fallait d’abord effectuer un an à l’externat, obtenir une certaine moyenne en classe avant de se voir attribuer une bourse d’études.
En 1963, je passe en classe de 1ère. Je suis boursier et je suis à l’internat. Cette année-là est, pour mes amis lycéens et moi-même, un moment de grand trouble car nous apprenons l’arrestation de certains ministres pour participation à un complot.
Trois ans après la proclamation des indépendances, ces ministres représentaient des “demi-dieux” pour les adolescents que nous étions. Nous pensions qu’ils étaient intouchables. S’ils étaient arrêtés, cela voulait dire qu’ils avaient effectivement participé à un complot. Il faut dire que nous n’avions aucun élément pour croire le contraire. À cela il faut ajouter que nous n’avions ni conscience critique, ni conscience politique. L’atmosphère sociale, qui était plus ou moins lourde, traduisait simplement le fait que les “demi-dieux” n’étaient que de simples individus et qu’il n’y avait pas d’hommes intouchables.
En juin 1964, j’arrive en vacances dans mon village, après avoir passé le concours France-Afrique, un concours organisé par le Ministère français de la Coopération pour les jeunes des classes de terminale, de première, de troisième, et du CM2.
Cette année-là, j’avais été un des lauréats. D’autres l’avaient été avant moi, tels Akoto Yao, Allassane Salif N’Diaye, Dominique Kangah.
Je devais donc aller en France dans le cadre du prix que je venais d’obtenir, quand mon père fut arrêté en ma présence, pour complicité dans un complot. Au moment où il allait être embarqué dans la voiture des gendarmes, il m’a dit :
– “Ce complot n’existe pas. Si moi, Koudou Paul, qui ne suis rien, qui n’ai fréquenté l’école que jusqu’au cours élémentaire deuxième année, on m’arrête, c’est que ce complot n’existe pas !”
Suivront les arrestations de Gris Camille et de nombreuses autres personnes originaires de la région de Gagnoa. Celle de Gris Camille, notre oncle, a été un choc dans la famille de ma mère. Elle en a beaucoup souffert, ainsi que ma grand-mère. D’ailleurs cette dernière en est morte….
Cette arrestation intervient alors que je n’avais même pas de quoi payer mon ticket de transport pour arriver à Abidjan, où j’étais attendu pour aller en France. C’est grâce à la générosité de l’épouse du directeur de l’école de Gagnoa, une institutrice, Madame Bamba qui m’a offert cinq cents francs que j’ai pu regagner Abidjan.
Revenu de ma colonie de vacances, je me suis trouvé confronté à un vrai problème. Je devais aller en terminale, tandis que ma sœur Jeannette entrait en classe de troisième, à Bouaké. Mon père était en prison, ma famille était démunie. Elle n’avait rien, moi non plus. Mes autres demi-frères, n’en parlons pas ! J’ai alors décidé de quitter l’école pour être instituteur dans les écoles privées, puisqu’il était un peu tard pour chercher un emploi dans les écoles publiques.
Des amis m’ont conseillé de ne pas abandonner. Il s’agissait pour moi de me battre pour obtenir le baccalauréat, ce qui aurait pour conséquence l’octroi d’une bourse d’études supérieures.
Parmi ces amis, je me plais à citer Dominique Kangah qui a toujours joué à mes côtés un rôle positif et Auguste Denise Georges, “compagnero, vecino.”
C’est ainsi que l’on s’appelait. Nous avions un orchestre, “Les Joyeux Compagnons du Lycée”, dans lequel il chantait avec N’Doly Boni. Ils m’ont beaucoup entouré de leur amitié. J’ai terminé l’année scolaire, obtenu le Bac et la bourse.
Je suis allé à l’université, orienté en lettres classiques pour être professeur de français, latin et grec. J’y ai passé une année de propédeutique à l’issue de laquelle j’étais admis à poursuivre mes études à Lyon.
Les choses s’annonçaient bien pour moi car j’allais profiter des grandes vacances de cette fin d’année scolaire 1965 pour effectuer un voyage d’études aux Etats Unis d’Amérique offert par l’Ambassade des USA.
Avant de m’y rendre, j’avais décidé de passer quelques jours dans ma région pour revenir aux sources. Et je me suis fait emprisonner par Ayémou Noué, le sous-préfet de Ouragahio.
Le 7 août, jour de la fête d’indépendance, il avait organisé un match de football qui opposait deux villages de la région, dont celui de ma mère.
L’équipe du village de ma mère remporte le match. Le sous-préfet refuse de lui remettre la coupe, mécontent parce que l’équipe qu’il soutenait avait perdu. Il s’en est suivi des bagarres. Il nous a fait tous arrêter et envoyer en prison à Gagnoa. On a dû y passer une vingtaine de jours.
Je me souviens très bien de cet épisode de la prison. J’apprenais par les avis et communiqués diffusés à la radio, l’invitation qui m’était faite d’aller retirer mon billet à l’Ambassade des Etats-unis.
J’ai raté ce voyage à cause de ce sous-préfet zélé que je n’ai d’ailleurs plus revu.
À la fin des vacances, je me suis envolé pour Lyon où j’ai rencontré deux personnes qui m’ont marqué. La première est une jeune fille, Jacqueline Chamois, qui est devenue ma première épouse, et avec laquelle j’ai eu mon fils aîné Michel Gbagbo.
La seconde est Gérard Colomb qui est devenu par la suite un ami. Il est aujourd’hui le maire de Lyon.
À Lyon où j’étais inscrit pour étudier le latin et le grec je me suis rendu compte que ces matières étaient très éloignées des préoccupations africaines ainsi que des préoccupations politiques ivoiriennes.
C’est très exaltant de parler du Péloponnèse, mais cela ne m’enseignait rien sur la vie politique de l’Afrique et de la Côte d’Ivoire.
C’est à partir de là que ma carrière politique s’est précisée d’autant, que j’avais commencé à assister à des réunions africaines en France et à des réunions de Français faisant de la politique. J’ai donc décidé d’étudier l’Histoire.
J’ai écrit au ministre de l’Education Nationale pour lui signifier ce changement d’orientation. Il m’a indiqué qu’il fallait dans ce cas revenir en Côte d’Ivoire. Jacqueline et moi nous sommes mariés et sommes rentrés au pays.
En septembre 1970 j’ai 25 ans. Je débute ma carrière d’enseignant, et je suis professeur au Lycée Classique.
Il faut savoir que nous étions 110 professeurs dont dix de race noire, huit Ivoiriens, une Nigériane, un Antillais et Mory Doumbia, qui était le premier proviseur noir au Lycée Classique,
J’étais un enseignant un peu atypique. Je ne me rendais pas souvent dans la salle des professeurs car je préférais être dans la cour avec les élèves. Ils m’aimaient beaucoup. Certains avaient le même âge que moi.
Nous étions pratiquement de la même génération et jouions ensemble dans les équipes de football.
Lorsque par exemple le censeur a demandé aux élèves d’élire le professeur principal de leur classe, j’ai été élu dans quatre classes.
À cette époque, nous avions dans le programme d’Histoire et de Connaissance Générale, le partage du monde en deux blocs. Un jour, je donnais un cours sur le partage du monde.
Après avoir défini les blocs, il fallait trouver des exemples précis.
J’ai donc parlé du conflit du Moyen-Orient, en disant qu’Israël était allié du bloc occidental et que l’Egypte de Nasser et les autres, étaient alliés du bloc soviétique. C’était le fond de ma pensée. Et cela correspondait à la vérité de cette époque.
La fille de l’Ambassadeur d’Israël n’a pas tellement apprécié cela parce que j’avais utilisé le mot impérialiste pour désigner le bloc occidental. Elle a levé la main et je lui ai donné la parole.
C’était une très bonne élève, la meilleure de mes élèves de terminale D. Elle voulait parler pour défendre l’image de son pays. J’ai refusé en expliquant qu’en début d’année, j’avais distribué des sujets d’exposés et qu’elle a choisi d’exposer sur les conflits au Moyen-Orient. Elle parlera donc à ce moment-là. Et puis en classe, il n’y a pas deux professeurs, il n’y en a qu’un seul et jusqu’à preuve du contraire, c’est moi. J’ai continué mon cours.
Au bout d’un moment elle s’est levée, et a quand même voulu s’exprimer. J’ai demandé au chef de classe d’aller chercher Monsieur Astar, le surveillant Je l’ai fait sortir de la salle, escortée par le surveillant.
J’ai terminé mon cours, et suis rentré chez moi. C’était un vendredi.
Le lundi, lorsque je suis arrivé au lycée, les élèves de toutes les classes étaient dans la cour. Ils avaient décidé de faire une grève générale ! J’ai demandé le motif, et c’est ainsi que j’ai appris que c’est parce qu’on devait me mettre aux arrêts.
Le proviseur m’a demandé des explications.
Pendant que je lui faisais le compte-rendu, l’ambassadeur d’Israël est entré dans le lycée, battant pavillon, ce qui a eu le don d’exaspérer les élèves qui étaient déjà surexcités.
Je n’ai pas accepté de le recevoir ne me sentant pas concerné par cette affaire. On me demande de dispenser un cours. Je le fais. Si j’estime qu’une élève a une inconduite, je demande qu’elle sorte de la classe. Je ne vois pas où est le problème.
Est-ce parce qu’elle est la fille d’un ambassadeur qu’il y a un problème ?
Après le départ de l’Ambassadeur, le ministre de l’Education Nationale, Lorougnon Guédé me convoque. Il désire me voir avec le proviseur.
Il nous a reçu, entouré de tous ses collaborateurs : directeur de cabinet, chef de cabinet, directeur de l’enseignement. Je n’y comprenais rien.
Ils m’ont posé une question assez incongrue :
– Quel type de cours dispensez-vous ?
J’ai rétorqué que je ne comprenais pas la question.
Le ministre m’a dit alors:
– Vous êtes accusé de donner des cours communistes.
À mon tour, je l’ai interrogé :
– Que veut dire un cours communiste ?”
L’atmosphère était assez électrique.
Mais ce qui est plus grave c’est que pendant ce temps, ils ont ramassé les cahiers de tous mes élèves des quatre classes pour vérifier si effectivement je donnais des cours communistes. De plus, ils leur ont distribué des feuilles pour qu’ils écrivent ce qu’ils pensent de moi. Ce sont mes élèves qui m’ont sauvé.
Quand j’ai été convoqué au ministère, tous les professeurs du Lycée ont décidé d’entamer une grève pour me soutenir. Ils ne comprenaient pas que le fait pour un professeur de sortir une élève d’une salle de classe devienne une affaire d’Etat.
Alors évidemment, j’ai rejoint le mouvement de grève.
Le lendemain, le lycée Sainte Marie, le lycée Technique, l’Université, se sont également mis en grève, suivis par toutes les écoles de Côte d’Ivoire.
Le président Houphouët-Boigny, constatant l’ampleur du mouvement, a délégué le Ministre des Affaires Etrangères, Usher Assouan, pour m’interroger, interroger le proviseur, les professeurs et les élèves.
Lorsque ce dernier a rendu son rapport, Houphouët-Boigny pour calmer le jeu a préféré renvoyer l’Ambassadeur et sa fille. Les cours ont repris. Quelques semaines après, j’ai été arrêté et envoyé de nouveau au camp militaire d’Akouédo.
Mon arrestation correspond aussi à celle des étudiants N’Dory Raymond, Sangaré Aboudrahamane, Kodjo Richard.… qui, pour protester contre le MEECI, avaient créé un syndicat différent, l’UCCI à l’Université d’Abidjan.
Nous venions d’être arrêtés et incarcérés encore à Akouédo quand un matin, M’Bahia Blé, le ministre de la Défense, arrive au camp militaire. Il nous rassemble tous sur la place d’armes et annonce:
– M. Gbagbo Laurent, votre épouse est une communiste de Lyon. Nous venons de la renvoyer.
– Avouez que c’est un motif assez cocasse. Comme si communiste de Lyon était plus dangereux que communiste de Moscou ou de Pékin !
Elle a été renvoyée sans le sou, avec mon fils âgé de deux ans, alors qu’elle était enseignante ici. Je les ai retrouvés deux ans plus tard, quand je suis sorti de l’armée.
Nous sommes embarqués pour la garnison militaire de la ville de Séguéla. C’est là que j’ai connu la plupart des mes futurs collaborateurs : Aboudrahamane Sangaré, Kadio Morokro Jean, Kodjo Richard. Je connaissais déjà N’Dori, mais nos liens se sont renforcés à Séguéla.
Nous avons passé sept mois à Séguéla. Les étudiants ont été libérés et nous les fonctionnaires, avons été conduits à l’Ecole des Forces Armées de Bouaké pour un séjour de quinze mois.Cela a été une expérience extraordinaire pour moi. Je découvrais l’armée et tout ce que cela comporte: les cadres, le fonctionnement, les institutions internes, etc.
On m’a offert gratuitement, pendant quinze mois, d’être au plus haut niveau de l’armée, c’est-à-dire là où tous les cadres militaires passaient.
J’y ai connu le général Robert Guéï, qui était à l’époque capitaine. Ils ont voulu me punir et ils m’ont puni parce que je n’étais pas content d’y être. En même temps, j’ai réussi en m’instruisant, à transformer cet aspect négatif en aspect positif.
Nous sommes libérés en janvier 1973. C’est cette année-là que l’histoire de la Côte d’Ivoire démocratique se dessine. Je vais vous dépeindre la situation globale pour que vous compreniez le contexte politique.
Il faut rappeler que déjà en 1969, à Strasbourg, nous avions créé l’embryon de ce qui deviendra plus tard le FPI. Nous étions quatre, issus des mouvements clandestins ivoiriens: Mamadou Traoré, Zadi Zaourou, Assoa Adou et moi-même.
Nos aînés qui avaient étudié en France et qui étaient opposants au régime d’Houphouët-Boigny ont créé un certain nombre de mouvements d’opposition,
le PAI (Parti Africain de l’Indépendance) qui avait une section en Côte d’Ivoire, le MIL (Mouvement Ivoirien de Libération) qui éditait régulièrement un organe, “le Pilon.” C’était bien entendu des mouvements clandestins indépendantistes et marxistes.
La faiblesse de ces mouvements résidait d’une part dans le fait qu’ils étaient dogmatiques, puisqu’il y avait les révolutionnaires et les non-révolutionnaires, et d’autre part, étant clandestins, ils avaient forcément une envergure peu significative.
À partir de 1970, ces mouvements vont se saborder et la plupart de leurs cadres rejoindront le PDCI-RDA. Je dis la plupart ; pas tous. Certains vont poursuivre le combat révolutionnaire dans des groupuscules clandestins marxistes-léninistes. C’est la première donnée qu’il faut avoir en tête.
Le deuxième élément, c’est que depuis 1963-1964, l’Université d’Abidjan fonctionnait normalement. Il n’était plus besoin d’aller en Europe pour des suivre des études supérieures.
Toute la partie oppositionnelle intellectuelle des étudiants est consommée sur place. Elle s’intègre dans tous ces mouvements clandestins qui se créent.
Le troisième élément est qu’entre 1969 et 1970 se créent dans le pays des syndicats qui auront pignon sur rue.
Djény Kobina et Angèle Gnonsoa créent le SYNESCI, ( Syndicat National des Enseignants du Secondaire de Côte d’Ivoire) D’autres, dont Francis Wodié, créent le SYNARES, ( Syndicat National de la Recherche Scientifique). Plus tard, le SYNACASSCI, le syndicat des médecins verra le jour.
Tous ces syndicats étaient autonomes vis-à-vis du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et de l’Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI) et revendiquaient leur non affiliation au PDCI et à L’UGTCI.
C’est dans ce cadre que je recouvre la liberté en janvier 1973 avec pour objectif la création d’un grand parti révolutionnaire qui va prendre le pouvoir à la place du PDCI-RDA.
C’est ainsi que Pascal Kokora, Aboudrahamane Sangaré, Simone Ehivet, Boga Doudou et moi, nous nous sommes réunis à la “Tour Golem” fin mars 1982, dans l’appartement n°42 de Pascal Kokora et que nous avons créé le parti qui sera le FPI, le Front Populaire Ivoirien. Le FPI est un parti politique né le 27 Mars 1982, il a tenu son congrès constitutif les 19 et 20 Novembre 1988. Il a été déclaré au Ministère de l’intérieur le 5 mai 1990.
Tout en assumant mes fonctions de directeur de l’institut d’histoire, je menais la lutte révolutionnaire et nous cherchions à expérimenter la voie de la “lutte pour la démocratie” quand Houphouët-Boigny nous a aidés malgré lui, en fabriquant le “Complot des enseignants bété” en 1982. Il n’y avait pas de complot du tout, encore moins de complot bété.
Qu’est-ce qui s’est passé ?
Le problème avec Houphouët-Boigny est qu’il avait beaucoup de flair. Même s’il n’avait pas les preuves, il sentait que nous préparions quelque chose. Il ne savait pas quoi. Alors il a voulu crever l’abcès pour le savoir.
Un jour, j’étais à mon bureau de l’institut d’histoire lorsque des étudiants du Mouvement des Etudiants et Elèves de Côte d’Ivoire (MEECI) sont venus me voir pour me demander de prononcer pour eux une conférence sur le thème “Peut-il y avoir démocratie dans un parti unique ? “J’ai refusé. Pour des questions de principe. Je suis contre le MEECI, et je le leur ai dit d’autant plus aisément que j’étais connu comme le “loup blanc”. Je n’avais pas à cacher que j’étais contre le MEECI, contre le PDCI. Tout le monde le savait.
Puis un autre groupe est venu me voir plus tard pour me demander de prononcer une conférence sur “Jeunesse et politique.” J’ai accepté.
Le jour où je suis arrivé sur le lieu de la conférence, le Théâtre de la Cité, tout le périmètre aux alentours était bouclé. Je suis donc reparti.
Le lendemain, Pierre Kipré, qui était le secrétaire général du SYNARES, m’a retrouvé à mon bureau pour me dire que depuis la veille les étudiants ont entamé une grève. La rumeur courait que j’avais été arrêté et de plus, Houphouët-Boigny m’accusait d’être l’instigateur de tous ces troubles.
Ce dernier, dans sa hargne de nous combattre, venait de nous offrir une chance historique de nous ouvrir la porte de l’exil. Ce que nos aînés n’ont jamais pu faire, prendre leurs responsabilités, c’était à nous de le faire.
L’un d’entre nous devait aller en exil pour faire connaître notre combat à l’extérieur et c’est moi qui ai été naturellement désigné. C’est à ce moment que commence une autre aventure. Aventure individuelle certes mais aussi aventure collective.
Le premier problème que j’ai eu à résoudre en France était de trouver un logement. Je n’avais pas d’argent, encore moins de statut.
Je suis allé dans un petit hôtel du 16e que je connaissais. J’y suis resté deux jours, et ensuite je me suis fait accompagner par Ouraga Obou qui était à Paris pour la rédaction de sa thèse, chez une de mes amies, Jocelyne Rodriguez. Elle disposait de deux chambres chez elle, et en a mis une à ma disposition.
C’est de chez elle que j’ai commencé à entreprendre les démarches pour l’obtention du statut de réfugié politique. La lettre que j’ai écrite à ce sujet a été publiée dans un manuscrit intitulé “Agir pour les libertés” en 1991.
En juillet, j’ai quitté le domicile de Jocelyne pour aller passer un mois chez un autre enseignant avant de m’installer à la rue des Escouffes chez une dame qui a gracieusement mis un appartement à ma disposition.
C’est dans cette maison, dans le quartier du Marais, que j’ai rédigé pendant l’hiver 1982, “Pour une alternative démocratique”, ouvrage édité par l’Harmattan en septembre 1983.
Ce livre était très important parce qu’il était en quelque sorte un appel :
– Un appel en direction de tous ceux qui étaient dans les cercles marxistes pour leur dire : écoutez, comprenez, ouvrez les yeux sur le monde tel qu’il est, et non pas tel que vous le rêvez.
– Un appel en direction des Ivoiriens pour leur dire que seule la démocratie permet le développement. Pour s’en convaincre, il suffisait de regarder la carte du monde. Tous les pays développés sont des pays démocratiques.
– Un appel enfin pour la mobilisation du peuple de Côte d’Ivoire, pour qu’à moyen ou long terme, nous puissions faire une alternance, non pas par les coups d’Etat, mais par les urnes.
De 1982 à 1986, Houphouët-Boigny m’ignore; mais alors de façon superbe. En 1986, il y a les élections législatives en France. La Droite gagne. Le président du RPR, Jacques Chirac, devient Premier Ministre. Peu de temps, après, Gaston Deferre meurt.
C’est à ce moment-là que je reçois un coup de fil d’un commissaire de police qui veut qu’on parle de la Côte d’Ivoire.
Je m’y rends en compagnie de mon ami Guy Labertit chez qui j’habitais. Le commissaire qui était accompagné d’un autre agent de police me dit:
– Nous ne voulons pas avoir une autre affaire Ben Barka. Le président Houphouët-Boigny a touché le gouvernement français, il nous a informés de votre décision de rentrer.
Je lui réponds :
– Moi, mon désir le plus ardent est de revenir dans mon pays. Mais pas maintenant. Pour le moment, je travaille à ce qu’il soit instauré un régime démocratique.
Nous avons discuté sans pouvoir nous comprendre, puis l’entretien a tourné court.
Évidemment, le lendemain, je me suis précipité au siège du journal ” Libération ” qui a écrit un article sur ce sujet et qui a titré avec humour: “Gbagbo, l’ivoirien qui n’a pas la côte”.
Je voulais me protéger. Dans ces situations, plus vous êtes dans l’anonymat, plus vous êtes exposés ; et plus on parle de vous, plus vous êtes protégés.
A partir de ce moment, je vais voir défiler plusieurs personnes qui prétendront venir me rencontrer au nom d’Houphouët-Boigny. Je ne sais pas si effectivement c’était le cas, cependant beaucoup d’Ivoiriens me demanderont de revenir au pays.
Mais avant de rentrer, il était essentiel que nous montrions au peuple de Côte d’Ivoire ce que nous allions réaliser une fois au pouvoir. Il était impératif d’écrire un programme de gouvernement.
Les cadres du FPI ont travaillé sur le sujet. Ils m’envoyaient les articles, je coordonnais, et corrigeais.
Le premier tome de ce programme – il n’y aura jamais de tome 2 – est publié en 1987 : ” Propositions pour gouverner la Côte d’Ivoire “.Dès lors, j’estimais que ma mission était accomplie. Je suis rentré le 13 septembre 1988.
Je rentrais pour continuer la lutte. Plus précisément, le parti était en train de préparer le congrès constitutif du Front Populaire Ivoirien. Je rentrais pour cela.
Mais auparavant, il fallait que je retrouve un travail. Le plus simple était que l’administration m’affecte de nouveau à l’institut d’histoire.
Autour d’Houphouët-Boigny, certains lui conseillaient de faire de moi le ministre de l’Education Nationale ; d’autres suggéraient plutôt de me confier le ministère de la Culture ou la direction d’une société privée ou publique. Il y avait toutes sortes de supputations sur les propositions. Mais je n’étais pas venu pour être ministre. J’étais venu continuer mon combat sur le terrain national.
Je dois à la vérité historique de souligner un trait d’Houphouët-Boigny. Lui-même, de sa bouche, ne m’a jamais proposé de l’argent, ni aucun poste. Ce sont des choses qui étaient toujours dites par son entourage.
Je voulais souligner ce point pour mettre les pendules à l’heure parce que souvent on met beaucoup de légende dans l’histoire. Je suis finalement retourné à l’institut d’histoire. Et c’était mieux ainsi, me semble-t-il, pour tout le monde.
Quand je suis parti en exil, le responsable du parti était de 1982 à 1986, Simone Ehivet. Ensuite Sangaré Aboudrahamane a pris la relève et en a assuré la responsabilité de 1986 à 1988.
Maintenant, il s’agissait d’exister, de tenir ce congrès constitutif pour doter notre parti d’un texte fondateur, d’un statut et d’un règlement intérieur. Il s’agissait d’élire des organes légaux et légitimes de ce parti. C’était une grande affaire.
Y participaient entres autres, Simone Ehivet, ma sœur Koudou Jeannette, Ouraga Obou, Boga Doudou, Ahibo Koffi, Maître Kouassi André, Bamba Maurice, Tapé Kipré et Aboudrahamane Sangaré. Certains se connaissaient, d’autres pas. Quant à moi, c’étaient la première fois que je rencontrais Tapé Kipré.
Au sortir du congrès, je suis rentré à Abidjan parmi les premiers. Anaky a quitté les lieux parmi les derniers avec Simone. Quand il l’a déposée à notre domicile, nous avons bu une bouteille de champagne pour fêter l’événement.
Puis il est rentré chez lui et a été arrêté.
Ce fut le début de moments pénibles que nous étions appelés à vivre.
A partir du moment où Anaky avait été arrêté, je n’étais plus réellement un clandestin. Je donnais des interviews, j’écrivais des articles que je dictais à des amis journalistes à Paris pour qu’ils les publient.
Nous déployions un certain nombre d’activités pour que notre ami ne reste pas en prison dans l’ignorance de tout le monde. Nous étions obligés de nous battre presque à ciel ouvert. C’était le début de la marche vers le multipartisme.
Durant cette période, il s’est passé deux faits marquants.
Le premier est que j’ai été mis à quatre reprises en résidence surveillée entre 1988, date de mon retour au pays et le 30 avril 1990, date de la proclamation du multipartisme.
Concernant le FPI, je réunis un jour les camarades et leur dis que c’est le moment d’aller à la préfecture d’Abidjan déposer les dossiers de reconnaissance de notre Parti. Fallait-il continuer à rester clandestin? Ne devions-nous pas forcer le destin?
J’ai tenu devant eux un raisonnement simple. Nous déposons les papiers. Si nous sommes arrêtés, l’effervescence va être encore plus grande dans les rues.
Il n’y avait plus de force de répression sur laquelle le pouvoir pouvait compter. Car l’armée elle-même avait déjà marché jusqu’à l’aéroport et faisait ce qu’elle voulait. Il fallait s’engouffrer dans cette brèche. Si nous n’étions pas arrêtés, c’est le multipartisme qui naîtra. Mais dans les deux cas, nous ne perdions rien. Nous sommes allés déposer les papiers. J’étais dans le rang avec Boga Doudou et Agbodio Paul. Dans ces cas-là, j’emmène toujours Boga parce qu’il est juriste.
Notre tour arriva. J’ai déposé les papiers devant l’employé de service. Il a regardé, s’est quelque peu affolé et reprenant ses esprits, a dit :
– Ah non! Monsieur, je ne peux pas. Prenez vos papiers. Allez voir le préfet ou le secrétaire général de préfecture. Mais moi, je ne peux pas les prendre.
C’était le 02 avril 1990. Nous allons donc voir le secrétaire général de préfecture. Il est de l’ethnie dida, la même que Boga et Agbodio.
Il consulte les papiers et dit en dida: “Qu’est-ce que vous me faites là? Attendez”.
Il décroche le téléphone et appelle le préfet chez lui.
Ce dernier lui dit : “Dites-leur de revenir demain”. Je suppose que c’était pour se donner un temps de réflexion pour consulter le ministre ou le président de la République.
Nous revenons le lendemain 03 avril.
Le préfet nous accueille très gentiment dans son bureau situé à l’époque sur le site actuel de la mosquée de la commune du Plateau.
Il reçoit les documents, les lit, appelle sa secrétaire et lui dicte la réponse qui était positive. Il signe, cachette et nous tend un récépissé. Nous le prenons et sortons.
Le multipartisme était né. C’est tout.
Nous étions le 3 avril 1990.
L’article 7 de la Constitution prévoyait déjà le multipartisme. Il fallait avoir du cran et la volonté pour forcer ce destin et faire revivre cet article 7.
Sortis de là, nous nous sommes précipités dans les locaux de RFI, BBC, et de la Voix de l’Amérique. Nous avons été interviewés. Grand moment d’émotion !
Les jours suivants, plusieurs partis sont allés se déclarer et déposer leurs dossiers.
Le 30 avril, le bureau politique du PDCI se réunissait, constatait qu’il n’y a plus un seul parti en Côte d’Ivoire, mais plusieurs et en prenait acte.
Le 04 mai, un décret officialisa l’existence des partis politiques, en application de l’article 7 de la Constitution.
Ce qu’il faut avoir à l’esprit, c’est que les conditions qui ont prévalu depuis 1989 dans le monde, et la poussée des militants à l’intérieur du pays, ont fait que le multipartisme a été concédé.
Je suis un croyant, et plus j’avance dans ma vie politique, plus s’impose à moi Dieu, et plus ma foi devient grande. Je ne suis pas un homme zélé, donc je ne fais pas de tapage autour de ma foi. Mais c’est très profond.
A partir du 30 avril 1990, j’avais parlé à un certain nombre de mes collaborateurs.
Je leur ai expliqué que je pouvais mourir tranquille parce que quand nous étions clandestins, beaucoup d’ivoiriens ne me comprenaient pas. Beaucoup me traitaient de fou. Comment un cadre, Docteur des universités françaises, au lieu de se mettre à la disposition unique de son savoir et de travailler à l’université, de répondre à l’appel d’Houphouët-Boigny, au lieu de tout cela, on le voit arriver le matin les yeux rouges, les cheveux non peignés. On ne sait pas d’où il sort, ce n’est pas normal. J’étais informé que ces discours se tenaient sur mon compte.
J’avais dit à certains de mes proches que c’est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu m’a aidé à sortir de la phase où les gens ne me comprenaient plus et qu’avec le multipartisme rétabli, désormais on savait pourquoi j’avais tant lutté.
Je savais exactement ce que je voulais.
En moi-même, j’avais la force de croire en Dieu et de regarder de très haut tous ceux qui gouvernaient. Je considérais qu’ils s’amusaient, qu’ils ne gouvernaient pas la Côte d’Ivoire. Je ne les prenais pas très au sérieux.
Je ne pouvais pas prendre au sérieux des gens dont la principale préoccupation était de devenir riche. Je n’ai jamais été un adorateur de l’argent. Tout le monde a besoin d’argent pour vivre. Moi-même j’en ai besoin. Je travaille, je gagne de l’argent, mais je dépense ce que j’ai. Je ne dépense pas ce que je n’ai pas.
Ma force sur mes adversaires était ma croyance en Dieu et ma non-croyance en l’argent.
Mais il y avait une chose au-dessus de tout, c’était la mort. C’était la main de Dieu seule qui pouvait m’empêcher de devenir chef d’Etat pour donner un autre visage de la Côte d’Ivoire.
En ce temps-là, le prophète que je citais le plus, était Moïse. Pourquoi Moïse ?
Parce qu’il est le père selon moi de tous les révolutionnaires. Il a créé à partir du néant. Moïse s’est présenté les mains nues devant Pharaon qui avait l’une des armées les plus puissantes du monde. Et c’est Moïse qui a gagné, ce n’est pas Pharaon.
J’étais convaincu de gagner à terme. Mais en même temps, je pensais qu’il était possible que je n’entre pas dans la Terre Promise.
Je pensais qu’il était possible que dans nos rangs qu’un un autre soit élu Président de la République en lieu et place de Laurent Gbagbo. Il était possible que je meure avant la victoire. Cela s’est vu dans beaucoup de cas de l’Histoire.
En Haute-Volta, c’est le cas de Ouézzin Coulibaly; en Centrafrique celui de Boganda, le père de la lutte pour l’indépendance. C’est David Dako qui a été élu Président de la République.
J’étais prêt à l’idée que la mort pouvait me chercher, avant même d’avoir gagné les élections. Cette idée était en moi. Je faisais cependant mon travail en laissant la conduite du destin à Dieu.
A partir du 18 février 1992, j’ai commencé à lire David. A me préparer à construire l’Etat.
J’ai lu presque tous les écrits de David, parce que j’ai compris que ma vocation était de construire un Etat nouveau.
Telle est ma conviction religieuse, telle est la force que j’ai puisée dans la Bible pour mon combat politique, et tel est à ce moment-là ce à quoi je pensais. C’est pourquoi, quand on m’a arrêté, je souriais. Je n’avais de problème ni à l’intérieur de mon être, ni à l’intérieur de mon âme. Je crois que ceux qui m’ont arrêté en avaient un.
1992, je suis emprisonné. Ce n’est pas la première fois que j’étais arrêté, mais la leçon que j’en ai tirée est la suivante : en politique, quand vous êtes en prison, ce n’est pas vous qui avez des problèmes. C’est celui qui vous a enfermé qui en a, parce qu’il se demande quand est-ce qu’il doit vous libérer. Vous, vous sortez lorsque la porte vous est ouverte. Tant que celle -ci reste fermée, vous vous organisez à l’intérieur de la prison.
La prison n’est pas non plus un obstacle à l’accession au poste de chef d’Etat. Quiconque croit qu’il peut empêcher quelqu’un d’être chef d’Etat en le mettant en prison se trompe.
Je pense qu’ils m’ont grandi, qu’ils m’ont honoré en m’arrêtant en 1992. Mais en même temps, ils m’ont montré leur limite. Ils m’ont montré qu’ils avaient peur. C’est cette peur qui m’a permis d’affirmer de façon sereine, de façon prophétique que je serai au pouvoir. Oui : de la prison à la présidence ! J’étais certain d’être au pouvoir après cette épreuve. Et j’y suis aujourd’hui.
Vous trouverez l’intégralité de cet entretien dans le DVD
“Laurent Gbagbo : la force d’un destin” film réalisé par Henri Duparc
 Fresco Courriels L’actualité sur la politique en Côte d’Ivoire
Fresco Courriels L’actualité sur la politique en Côte d’Ivoire